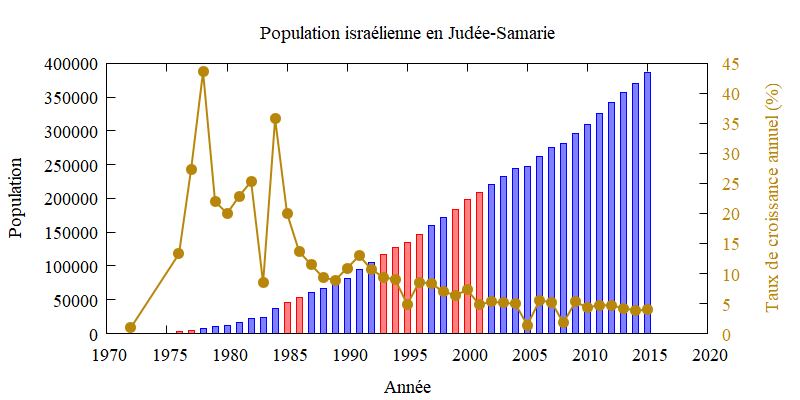La Conférence de paix de Paris
À l’issue de la Première Guerre mondiale, les Alliés vont redessiner les frontières européennes et moyen-orientales par une série de traités internationaux. Les travaux menant aux nouveaux traités de paix et aux nouvelles frontières se déroulent à la Conférence de paix de Paris de 1919. Cette conférence de 32 nations va consacrer la création de la Société des Nations (SDN) et démanteler l’Empire allemand, l’Empire austro-hongrois et l’Empire ottoman. Il en résultera une série de traités (Traité de Neuilly-sur-Seine, 1919 ; Traité de Saint-Germain-en-Laye, 1919 ; Traité de Versailles, 1919 ; Traité de Trianon, 1920) par lesquels les vaincus cèdent des territoires, soit directement à des États victorieux voisins, soit aux principales puissances militaires ayant permis de gagner la guerre, lesquelles en disposent ensuite avec les autres alliés. Ces Principales Puissances Alliées sont au nombre de quatre : la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et le Japon. Les États-Unis sont désignés comme Puissance Associée.
Convaincus par le Président américain Woodrow Wilson, les Principales Puissances Alliées vont renoncer à leurs propres droits sur les territoires résultant du démembrement des colonies des puissances vaincues et de l’Empire ottoman au profit des nations indigènes et mettre en place un système de Mandats permettant d’amener à maturité les nouveaux États à créer sous la tutelle des Principales Puissances Alliées. Le système des Mandats fut inscrit dans le Pacte de la Société des Nations (Art. 22) signé le le 28 juin 1919 et entré en vigueur le 10 janvier 1920. Les deux premiers paragraphes de l’Art. 22 stipulent :
Aux colonies et territoires qui, à la suite de la dernière guerre, ont cessé d’être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient jadis et qui sont habités par des peuples qui ne sont pas encore capables de se tenir debout dans les conditions pénibles du monde moderne, devrait être appliqué le principe selon lequel le bien-être et le développement de ces peuples constituent une mission sacrée dans la civilisation et que les garanties pour l’exercice de cette responsabilité devraient être incorporées dans le Pacte.
La meilleure façon de donner effet à ce principe est que la tutelle de ces peuples soit confiée à des nations avancées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, puissent mieux assumer cette responsabilité et acceptent de le faire, et que cette tutelle devrait être exercée par eux en tant que mandataires au nom de la Ligue.
Dans la partie palestinienne, syrienne et mésopotamienne de l’Empire ottoman, les nations indigènes qui furent invitées à déposer une requête étaient les Juifs et les Arabes. Les Juifs étaient représentés par l’Organisation sioniste et les Arabes par le Prince Fayçal ben Hussein el-Hachimi Eljai, le futur roi d’Irak et fils du chérif de La Mecque Hussein ben Ali. Le Prince Fayçal déposa une requête demandant la création d’un État d’Arabie unique comprenant la Syrie, la Mésopotamie et l’Arabie, mais excluant la Palestine. De son coté, l’Organisation sioniste déposa aussi une requête dont les éléments essentiels étaient que :
- « les Parties contractantes reconnaissent le titre historique du peuple juif sur la Palestine et le droit des Juifs de reconstituer en Palestine leur Foyer national. »
- « les frontières de la Palestine soient déclarées » comme indiqué sur la carte ci-dessous (le texte de la requête détaille le tracé en mots).
- le Mandat pour la Palestine soit conféré à la Grande-Bretagne par la SDN.
- le Mandat soit sujet à la condition suivante : « que la Palestine soit placée dans des conditions politiques, administratives et économiques qui y assureront l’établissement du Foyer national juif et finalement rendent possible la création d’un État autonome, étant clairement entendu que rien ne doit être fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine ou aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays. »

Il est important de noter que la Palestine sur laquelle l’Organisation sioniste demandait la reconnaissance du titre historique du peuple juif et sur laquelle elle demandait de pouvoir reconstituer son Foyer national correspondait à l’antique Royaume d’Israël et comprenait des territoires situés tant à l’ouest qu’à l’est du Jourdain (mais pas toute la Jordanie actuelle). Le mot « reconstituer » lui-même a son importance. Il ne s’agissait pas de créer quelque chose de neuf, mais de retrouver la souveraineté du peuple juif sur son ancien foyer national. Il était également entendu que l’Organisation sioniste avait pour intention de créer un État juif dans lequel chaque Juif pourrait immigrer (voir la requête) et dans lequel tous les citoyens juifs ou non juifs auraient les mêmes droits. Avec quelque 14 millions de Juifs dans le monde dont une grande partie émigrerait vers la Palestine une fois que le pays se serait un peu développé, l’Organisation sioniste estimait que les 700.000 Arabes vivant en Palestine en 1920 deviendraient rapidement une minorité politique. En utilisant la même formule de réserve que dans la Déclaration Balfour (« rien ne doit être fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine ou aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays »), l’Organisation sioniste entendait rappeler son engagement à respecter les droits de cette future minorité ethnique et religieuse si les Principales Puissances Alliées acceptaient de l’on transformât la Palestine en un pays où le peuple juif serait politiquement souverain.
Les Juifs et les Arabes soutenaient leurs requêtes mutuelles via l’Accord Fayçal-Weizmann. Cependant, la requête arabe déplut beaucoup aux Français. On décida de reporter l’examen des deux requêtes.
La Conférence de San Remo
Afin de réexaminer ces requêtes (et prendre des décisions sur d’autres sujets), les Principales Puissances Alliées décidèrent de se réunir dans la ville italienne de San Remo. C’est là que pour la première fois dans l’histoire, la promesse informelle de la Déclaration Balfour allait être traduite dans le droit international par l’acceptation de la requête juive. À la Conférence de San Remo (19-26 avril 1920), les Principales Puissances Alliées prirent la décision de créer trois Mandats par application de l’Art. 22 du Pacte de la Société des Nations : un Mandat pour la Mésopotamie (Irak), un Mandat pour la Syrie et le Liban et un Mandat pour la Palestine. En accédant à la requête de l’Organisation sioniste et créant un Mandat séparé pour la Palestine, les Principales Puissances Alliées reconnaissaient les liens historiques du peuple juif avec la Palestine et l’autorisaient à reconstituer dans ce pays son Foyer national. Pour souligner cela, les Principales Puissances Alliées décidèrent de faire explicitement référence à la déclaration Balfour dans le texte de synthèse de la Conférence :
Les Hautes Parties contractantes conviennent de confier, par application des dispositions de l’article 22, l’administration de la Palestine, dans les limites qui peuvent être déterminées par les Principales Puissances Alliées, à un mandataire, à choisir par lesdites puissances. Le Mandataire sera responsable de la mise en vigueur de la déclaration faite à l’origine par le gouvernement britannique le 8 novembre 1917 et adoptée par les autres puissances alliées, en faveur de l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, étant clairement entendu que rien ne doit être fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays.
La Palestine destinée à accueillir le Foyer national juif fut décidée plus grande que le territoire de la requête, limitée par la Syrie (et le Liban) au nord, la Mésopotamie (Irak) et l’Arabie à l’est — voir la carte ci-dessous. Si la frontière nord était assez bien définie, l’extension à l’est de la partie transjordanienne était ouverte à discussion. La fixation définitive des frontières aurait lieu plus tard.

En s’adressant à la Conférence sioniste annuelle le 7 juillet 1920, Chaim Weizmann déclara :
La décision de San Remo est venue. Cette reconnaissance de nos droits en Palestine est inscrite dans le Traité avec la Turquie et fait maintenant partie du droit international. C’est l’événement politique le plus important de toute l’histoire de notre mouvement et il n’est peut-être pas exagéré de le dire dans toute l’histoire de notre peuple depuis l’exil.
Le Traité de Sèvres
Le « Traité avec la Turquie » auquel Chaim Weizmann faisait allusion était le Traité de Sèvres conclu le 10 août 1920 et qui consacrait le démantèlement de l’Empire ottoman. Les trois autres instruments de droit international qui découlent des décisions prises à San Remo sont le Mandat pour la Palestine (confirmé par la SDN le 24 juillet 1922 et entré en vigueur le 29 septembre 1923), le Mandat pour la Syrie et le Liban (confirmé par la SDN le 24 juillet 1922 et entré en vigueur le 29 septembre 1923), le Mandat pour la Mésopotamie (jamais ratifié et remplacé par le Traité Anglo-iraquien d’octobre 1922).
L’Art. 95 du Traité de Sèvres reprend mot pour mot la décision des Principales Puissances Alliées prise à San Remo et l’Art. 96 précise qu’il incombera à la SDN de nommer les Puissances Mandataires pour les trois Mandats créés à San Remo et de rédiger les termes de ces Mandats. Le Traité de Sèvres devait aussi créer une « région autonome du Kurdistan » et officialiser la « République d’Arménie » qui existait dans les faits depuis 1918, en vertu de la même « doctrine de Wilson » favorable à l’indépendance des peuples indigènes qui avait bénéficié au peuple juif. Malheureusement, la guerre civile en Turquie et la guerre de celle-ci avec la Grèce empêchèrent sa ratification par l’ensemble des États concernés, d’autant plus que les termes du traité lui-même ravivèrent le nationalisme turc. Après la victoire des kémalistes en Turquie, le Traité de Sèvres fut déclaré caduc.
La Conférence du Caire
La création de deux Mandats différents pour les territoires arabes donnait certes l’indépendance politique à la nation arabe ainsi que l’assistance économique et administrative qu’elle recherchait, mais allait à l’encontre de la volonté de Fayçal de former un État arabe unique. Cela provoqua des troubles en Syrie entre les tribus arabes alliées de Fayçal et les Français. Les Français imposèrent le Mandat pour la Syrie et le Liban en chassant Fayçal qui se réfugia en Irak. En compensation, les Britanniques donnèrent à Fayçal le trône d’Irak. Mais cela ne mit pas un terme au conflit. Le Prince Abdallah, frère de Fayçal, entreprit de reprendre Damas aux Français. Pour calmer la situation, Winston Churchill invita Abdallah à prendre le thé avec lui à l’occasion de la Conférence du Caire en mars 1921. Pendant cette conversation, il proposa de lui offrir le territoire transjordanien sous Mandat britannique contre la fin des hostilités avec les Français en Syrie. Abdallah accepta le marché sous condition que la reconstitution du Foyer national juif ne s’appliquât pas sur la rive orientale du Jourdain. Le territoire prévu pour la reconstitution du Foyer national juif se voyait donc amputé du territoire transjordanien.
Le Traité de Lausanne
La renégociation du Traité de Sèvres produisit le Traité de Lausanne. Celui-ci fut signé le 24 juillet 1923 et entra en vigueur le 6 août 1924. Pour accommoder le nouveau pouvoir turc, l’indépendance de l’Arménie et du Kurdistan passa à la trappe. Contrairement au Traité de Sèvres, le Traité de Lausanne ne traite pas de l’avenir des territoires perdus par l’Empire ottoman, mais uniquement des obligations et droits de la nouvelle Turquie. Les Mandats créés à San Remo n’y sont pas mentionnés. Ils ont d’ailleurs été finalisés et ratifiés avant la signature du Traité de Lausanne, mais il a fallu attendre cette signature pour les faire entrer officiellement en vigueur car la Turquie devait reconnaître que ces territoires n’étaient pas siens (pour la Palestine, c’est l’Art. 16 du Traité de Lausanne qui est relevant).
Le principe des Mandats de la SDN
Il résulte de l’annulation du Traité de Sèvres que l’implémentation légale des décisions de San Remo se trouve dans les Mandats accordés par les Principales Puissances Alliées par application de l’Art. 22 du Pacte de la Société des Nations avec l’aval des 51 membres de la SDN. Le système des Mandats est très particulier. Comme le dit l’Art. 22 du Pacte de la Société des Nations, les Mandats s’exercent au nom et au bénéfice « des peuples qui ne sont pas encore capables de se tenir debout dans les conditions pénibles du monde moderne » et qui en firent la requête à Paris en 1919 suivant « le principe selon lequel le bien-être et le développement de ces peuples constituent une mission sacrée dans la civilisation » à laquelle il ne pourrait être dérogé. Pour ce faire, les peuples requérants ou mandants sont placés sous la tutelle de « nations avancées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, puissent mieux assumer cette responsabilité et acceptent de le faire ». Ces nations tutrices ne peuvent pas faire ce qu’elles veulent : elles doivent exécuter un Mandat spécifique, rédigé par les Principales Puissances Alliées et destiné à développer au bénéfice du mandant des institutions nationales solides lui permettant d’exercer sa pleine souveraineté sur le territoire concerné par le Mandat : elles sont mandataires. La SDN joue trois rôles : (i) elle valide le texte du Mandat, (ii) elle valide le mandataire choisi par les Principales Puissances Alliées, (iii) elle est la garante de la bonne exécution du Mandat (« les garanties pour l’exercice de cette responsabilité devraient être incorporées dans le Pacte »). L’Art. 22 crée une situation de fidéicommis dans laquelle les Principales Puissances Alliées (fideicommittens) chargent la SDN (fiduciarius) d’exécuter un Mandat au bénéfice d’un mandant (fideicommissarius) en nommant un mandataire approprié.
La Grande-Bretagne fut choisie comme mandataire pour la Palestine et l’Irak ; la France fut choisie comme mandataire pour la Syrie et le Liban. Tous ces mandats étaient de type A au sens de l’Art. 22 du Pacte de la Société des Nations car il fut considéré que les mandants « ont atteint un stade de développement où leur existence en tant que nations indépendantes peut être provisoirement reconnue, sous réserve de la prestation de conseils et d’une assistance administrative par un mandataire jusqu’à ce qu’ils puissent se tenir seuls ». Bien que mis sous tutelle jusqu’à ce que les mandants fussent capables d’administrer seuls leur territoire, la Palestine, le Liban, la Syrie et l’Irak furent reconnus comme des nations indépendantes provisoires dès l’entrée en vigueur des Mandats et appelées à rejoindre la SDN à la terminaison du Mandat (comme l’Irak en 1932). Ils différaient en cela des mandats de type B et C dont les peuples mandants étaient considérés comme n’ayant pas encore atteint un stade d’organisation suffisamment avancé.
Le mandat pour la Palestine
Le Mandat pour la Palestine est organisé comme suit. L’Art. 2 énonce qui est le bénéficiaire du Mandat, c’est-à-dire le mandant :
Le mandataire est responsable de placer le pays dans les conditions politiques, administratives et économiques qui assureront l’établissement du Foyer national juif, tel que stipulé dans le préambule, et le développement des institutions autonomes, ainsi que de préserver les droits civils et religieux de tous les habitants de la Palestine, sans distinction de race et de religion.
Le préambule du Mandat reprend textuellement les termes de la déclaration Balfour, de la requête du peuple juif de 1919, de la résolution de San Remo et de l’Art. 95 du Traité de Sèvres : « […] les Principales Puissances Alliées ont également convenu que le mandataire serait chargé de mettre en vigueur la déclaration faite le 2 novembre 1917 par le gouvernement de Sa Majesté britannique et adoptée par lesdites Puissances en faveur de l’établissement en Palestine d’un Foyer national pour le peuple juif, étant clairement entendu que rien ne devrait être fait qui pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine, ou les droits et le statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays. » Et le préambule de rappeler que le Mandat est accordé en vertu du fait que la « reconnaissance a été donnée à la connexion historique du peuple juif avec la Palestine et au bien fondé de la reconstitution de leur foyer national dans ce pays ».
De quelle Palestine est-il question ? Sur la carte précédente, le contour de la Palestine demandée par l’Organisation sioniste est représenté par un large trait bleu. La Palestine définie par le Mandat est délimitée par le trait-point rouge. Pour réaliser la promesse faite par Churchill à Abdallah lors de la Conférence du Caire, les Britanniques procédèrent en deux étapes. Premièrement, on ouvrit la voie à un possible détachement de la Transjordanie en créant l’Art. 25 du Mandat :
Dans les territoires situés entre le Jourdain et la frontière orientale de la Palestine, tels qu’ils seront déterminés, le Mandataire aura le droit, avec l’assentiment du Conseil de la Société des Nations, de différer ou de suspendre l’application des dispositions du présent Mandat qu’il jugera inapplicable aux conditions locales existantes et de prévoir pour l’administration des territoires les dispositions qu’il juge appropriées à ces conditions, à condition qu’aucune mesure incompatible avec les dispositions des articles 15, 16 et 18 ne soit prise.
Ensuite, après la signature du Mandat pour la Palestine le 24 juillet 1922, la Grande Bretagne présenta à la SDN le Mémorandum sur la Transjordanie expliquant comment elle allait implémenter l’Art. 25. Ce mémorandum annulait toutes les clauses du Mandat concernant l’établissement d’un Foyer national juif sur le territoire transjordanien. Il fut approuvé par la SDN le 16 septembre 1922. Sur la carte ci-dessus, le territoire transjordanien, ou Palestine arabe, est représenté en rouge. La Palestine juive, sur laquelle le Mandat prévoit l’établissement du Foyer national juif, s’étend donc de la mer au Jourdain et est représentée en orange sur la carte. Le mandat entra officiellement en vigueur le 29 septembre 1923.
Afin de reconstituer le Foyer national juif sur le rive occidentale du Jourdain, le Mandat pour la Palestine impose à la Puissance mandataire plusieurs dispositions :
- Elle doit reconnaître officiellement une « organisation juive appropriée » (en pratique l’Organisation sioniste) qui conseillera et coopérera avec l’Administration de la Palestine sur tous les sujets « qui peuvent concerner la fondation du Foyer national juif et les intérêts de la population juive de Palestine. » [Art. 4]
- La Puissance mandataire doit « faciliter l’immigration juive dans des conditions appropriées et encourager, en coopération avec l’organisation juive visée à l’Art. 4, l’installation des Juifs sur le territoire, y compris les terres d’État et les terres incultes non nécessaires à des fins publiques. » [Art. 6] En particulier, elle doit veiller à ce que la loi « facilite l’acquisition de la citoyenneté palestinienne par les Juifs qui prennent leur résidence permanente en Palestine. » [Art. 7]
- La Puissance mandataire est incitée à s’entendre avec l’organisation juive visée à l’Art. 4 pour « effectuer ou exploiter, dans des conditions justes et équitables, tous travaux et services d’utilité publique et pour développer toutes les ressources naturelles du pays, dans la mesure où ces questions ne sont pas directement traitées par l’administration. » [Art. 11]
- « L’anglais, l’arabe et l’hébreu seront les langues officielles de la Palestine. Toute déclaration ou inscription en arabe sur des timbres ou de l’argent en Palestine doit être répétée en hébreu et toute déclaration ou inscription en hébreu doit être répétée en arabe. » [Art. 22] (Voir l’illustration représentant une livre palestinienne et un timbre palestinien de l’époque du Mandat.)
- « L’Administration de la Palestine reconnaîtra les jours saints des communautés respectives en Palestine comme des jours de repos légaux pour les membres de ces communautés. » [Art. 23]

On mesure mal aujourd’hui l’importance des Art. 22 et 23. En mettant toutes les religions sur un pied d’égalité, le Mandat confirmait l’abolition du statut de « dhimmis » qui avait existé sous l’Empire ottoman pour les juifs et les chrétiens jusqu’en 1859 (abolition de la djeziya) maintenant les non musulmans dans un état de citoyens de seconde zone. En déclarant l’hébreu langue officielle en Palestine au même titre que l’arabe, le Mandat allait même plus loin : il reconnaissait non seulement le lien historique entre le peuple juif dispersé et la Palestine, mais aussi l’existence de la communauté juive déjà établie dans son Foyer national. Depuis le début du 20ème siècle, trouvant le nombre de Juifs trop important en Palestine, les Ottomans les en chassaient. Ainsi, pendant la Première Guerre mondiale, l’Empire ottoman refusait de naturaliser des Juifs de nationalité étrangère et les expulsait ; beaucoup partirent à Alexandrie. En 1915-1917, le maître ottoman de la Palestine et de la Syrie, Djemal Pacha, organisa la répression contre les Juifs. Le 9 avril 1917, devant l’avancée britannique, il ordonna l’expulsion des habitants de Tel Aviv et Jaffa, qui durent partir se réfugier au nord. Près de 20 % des 10.000 personnes expulsées ce jour-là décédèrent de maladie, dont une majorité d’enfants et de vieillards. La répression ottomane fit passer la population juive de 94.000 âmes en 1914 (soit 14% de la population) à 76.000 en 1920 (soit 11% de la population). L’entrée en vigueur du Mandat signifiait que dorénavant les Juifs locaux pouvaient se sentir chez eux dans toute la Palestine, de la mer au Jourdain, et les nouveaux immigrants savaient qu’ils venaient dans un pays sans discrimination religieuse et dans le seul pays où leur langue avait le statut de langue officielle de l’administration.
L’Art. 4 obligeait le mandataire à travailler main dans la main avec l’Organisation sioniste (le mandant) sur toutes les questions relatives à la vie juive et la reconstitution du Foyer national juif en Palestine. L’Organisation sioniste acquérait de ce fait un statut particulier : elle assistait et conseillait le gouvernement de tutelle. Elle devait se préparer à prendre le relais du gouvernement britannique à la fin du Mandat. Pour cette raison, l’Art. 11 encourageait le mandataire à lui confier des tâches de gestion des services publics ou liées au développement des ressources naturelles du pays.
La condition sine qua non pour que la Palestine redevienne le Foyer national juif était bien entendu que l’immigration juive et la naturalisation des nouveaux arrivants fussent facilitées et encouragées. C’était l’objet des Art. 6 et 7. En effet, le Mandat pour la Palestine fut créé à la demande de l’Organisation sioniste et au nom du peuple juif qui, à l’époque, comptait presque 14 millions d’individus dispersés dans le monde. Le but du Mandat (et donc aussi sa condition de terminaison) était de faire en sorte qu’une fraction significative du peuple juif vînt s’établir en Palestine pour que celle-ci devînt un pays démocratique où les Juifs disposeraient d’une souveraineté politique du fait de leur majorité numérique par rapport aux Arabes, de la même manière que les Arabes disposaient d’une majorité numérique en Syrie et en Irak par rapport à d’autres peuples locaux, comme les Druzes, les Kurdes ou les Yazedis. Il est important de noter que l’Art. 6 imposait au mandataire une obligation légale de faciliter l’immigration et l’installation des Juifs sur l’ensemble du territoire palestinien, notamment en leur permettant d’acquérir à titre privé des terres appartenant à l’État. L’Art. 4 assurait que ce processus fût supervisé par l’Organisation sioniste via un droit de regard et de conseil.
Il est important de noter que le Mandat pour la Palestine traite tous les citoyens palestiniens, qu’ils soient Juifs ou les non Juifs, sur un strict pied d’égalité : les droits individuels, civils et politiques, sont garantis pour tous. Par contre, le Mandat ne reconnaît à aucun autre peuple que le peuple de juif de droits politiques collectifs sur la Palestine tels que ceux cités ci-dessus. En particulier, les Arabes ne se voient reconnaître ni droits ni privilèges politiques particuliers en tant que peuple en Palestine parce que ces droits leur sont déjà acquis dans le reste de la péninsule arabique et que les Principales Puissances Alliées décidèrent à San Remo de réserver la Palestine au bénéfice singulier du peuple juif.
Le destin séparé de la Transjordanie
Abdallah installa son gouvernement le 11 avril 1921. La Transjordanie devint un émirat sous tutelle britannique formellement intégré au Mandat pour la Palestine. Dans les faits, les Britanniques administraient l’Émirat de Transjordanie comme un Mandat différent de celui de la Palestine. L’Émirat reçut progressivement plus d’indépendance. Les Britanniques mirent fin à leur Mandat en Transjordanie en signant avec elle le 22 mars 1946 le Traité de Londres. L’Art. 8 du traité signale la terminaison des obligations mandataires de la façon suivante :
- Toutes les obligations et responsabilités dévolues à Sa Majesté le Roi vis-à-vis de la Transjordanie à l’égard de tout instrument international qui n’est pas juridiquement terminé devraient être confiées à Son Altesse l’Émir de Transjordanie et les Hautes Parties contractantes prendront immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer le transfert de ces responsabilités à Son Altesse l’Émir.
- Tout traité, convention ou accord international général qui a été rendu applicable à la Transjordanie par Sa Majesté le Roi (ou par son gouvernement au Royaume-Uni) en qualité de mandataire continuera d’être observé par Son Altesse l’Émir jusqu’à Son Altesse l’Émir (ou son gouvernement) devienne une partie contractante distincte ou que l’instrument en question soit juridiquement terminé à l’égard de la Transjordanie.
Le 18 avril 1946 la SDN reconnu l’indépendance du pays. Le Traité de Londres entra en vigueur le 17 juin 1946. Le 25 mai 1946, l’émirat fut rebaptisé Royaume hachémite de Jordanie.
La période mandataire et les livres blancs
La perspective fixée par le Mandat pour la Palestine d’une prochaine souveraineté juive sur l’ancienne province ottomane de Palestine ne plaisait pas à une grande partie de la population arabe qui trouvait inacceptable d’être la seule population arabe de tout le Proche et Moyen Orient à ne pouvoir jouir de l’indépendance nationale après s’être extraite de la domination ottomane. Nombreux Arabes pensaient que leur majorité présente leur donnait le droit de diriger le pays et refusaient les termes du Mandat pour la Palestine.
Plusieurs violentes agressions anti-juives (dans certains cas de véritables pogroms) eurent lieu entre 1921 et 1947, forçant les Britanniques à pratiquer une politique d’apaisement particulièrement inefficace. Elle consista notamment à publier des textes interprétatifs du Mandat pour la Palestine appelés Livres blancs destinés à préciser la politique mandataire ou à en modifier les principes. Bien que sans valeur juridique en droit international, les Livres blancs permettent de comprendre à quel point les Britanniques éprouvaient des difficultés à maintenir l’ordre et exécuter le Mandat que la SDN leur avait octroyé au nom des Principales Puissances Alliées.
Le Premier Livre blanc
Le Premier Livre blanc, appelé Livre blanc de Churchill, parut le 3 juin 1922 avant même la désignation officielle de la Grande-Bretagne comme Puissance mandataire en Palestine. Il faisait suite aux sanglantes émeutes anti-juives de 1921 à Jaffa. Il visait à répondre de façon apaisante aux inquiétudes des Arabes et à rasséréner les Juifs sur le fait que les termes du Mandat pour la Palestine seraient bien respectés. Les principaux points traités par le Livre Blanc de Churchill étaient les suivants :
- Anticipant la prochaine séparation de la Transjordanie, Churchill rassura les Arabes que la Palestine n’était pas destinée à se judaïser dans son entièreté ni que jamais il n’avait été envisagé de subordonner ou de faire disparaître la population, la langue et la culture arabe en Palestine. Dans la partie de la Palestine appelée à se judaïser selon les termes du Mandat, Churchill rappela en citant la déclaration de l’Organisation sioniste à Carlsbad (septembre 1921) « la détermination du peuple juif à vivre avec le peuple arabe dans un esprit d’unité et de respect mutuel, et avec eux de faire de leur maison partagée une communauté florissante, dont l’édification peut assurer à chacun de ses peuples un développement national serein.»
- Constatant que la communauté juive en Palestine était bien organisée du point de vue politique, religieux et social, et qu’elle possédait sa langue et ses coutumes, Churchill pointa qu’elle possédait déjà un caractère national certain et que le « développement du Foyer national juif en Palestine » visait la continuation du développement de cette communauté, avec l’aide de Juifs de l’étranger, afin qu’elle devienne un centre qui capterait l’intérêt et la fierté du peuple juif dans son ensemble et non — comme le redoutaient les Arabes — l’imposition d’une nationalité juive à tous les habitants de la Palestine. Et Churchill ajouta que « pour que cette communauté ait les meilleures perspectives de développement libre et pour donner au peuple juif la pleine opportunité de montrer ses capacités, il est essentiel qu’il sache qu’il est en Palestine de plein droit et non par tolérance » et que, pour cette raison, les droits du peuple juif devaient être garantis internationalement et reconnu sur la base des liens historiques anciens qui lient les Juifs à ce pays. L’accomplissement de cette politique impliquait « nécessairement que la communauté juive en Palestine pût augmenter en nombre par l’immigration », cette immigration ne pouvant pas être plus importante en volume que ce que la capacité économique du pays permettait d’absorber.
- Churchill rassura la communauté arabe sur le fait que l’Art. 4 du Mandat (voir ci-dessus) n’impliquait pas que l’Exécutif sioniste palestinien prendrait part à l’administration générale du pays durant le Mandat, mais qu’il s’occuperait principalement des intérêt juifs, tout en assistant le gouvernement et participant au développement général du pays.
Le Second Livre blanc
Le Second Livre blanc, dit Livre blanc de Passfield, parut le 21 octobre 1930 en réponse aux émeutes sanglantes de 1929, dont le terrible massacre d’Hébron qui mit fin à la présence pluricentenaire des Juifs dans cette ville de Judée abritant le Tombeau des Patriarches. Plusieurs points en ressortaient :
- Passfield y niait que le but principal du Mandat reçu par la Grande-Bretagne concernait l’établissement d’un Foyer national juif en Palestine, faisant valoir que le développement de la population arabe était un objectif d’importance équivalente.
- Passfield voulait imposer la création d’une Assemblée législative commune comprenant des officiels britanniques et des membres non-officiels élus dans les communautés juives et arabes. Cette idée ne plaisait pas aux Juifs qui y voyaient un moyen de légitimer « démocratiquement » des législations défavorables et contraires aux objectifs du Mandat pour la Palestine. Elle ne plaisait pas non plus aux Arabes qui exigeaient une représentation proportionnelle dans laquelle ils auraient toujours la majorité et avaient déjà refusé, dans le passé, de participer au gouvernement via une telle assemblée.
- Passfield faisait valoir qu’il n’y avait plus assez de terres cultivables disponibles pour des nouveaux immigrants mis à part les terres déjà acquises par les agences de développement juives. Il avançait, d’une part, que les Arabes ne devaient pas vendre de terres aux Juifs car un grand nombre d’entre eux était aujourd’hui sans terre et sans emploi et, d’autre part, que l’État ne pouvait non plus vendre de terres publiques aux Juifs « en raison de leur occupation effective par les cultivateurs arabes [NDLR: effective signifie ici sans titre de propriété] et de l’importance de mettre à disposition des terres supplémentaires sur lesquelles placer les cultivateurs arabes qui sont maintenant sans terre. »
- Passfield reprochait à l’Agence juive de développer les implantations agricoles juives en Palestine sans se soucier des intérêts économiques des Arabes, en particulier en employant de la main d’œuvre immigrée juive alors que des Arabes locaux étaient sans emploi. Il voulait imposer que la gestion de toutes les terres disponibles et des transferts de terres privées entre propriétaires fussent placés sous l’autorité de l’Administration britannique.
- À la lumière du contraste entre la réussite économique de la société juive et le manque de développement économique de la société arabe, Passfield proposait de limiter l’immigration juive de travail.
Le ton général du Livre blanc de Passfield était clairement anti-sioniste et le programme politique proposé fut compris par les Juifs de Palestine comme une entorse sévère à l’esprit et à la lettre du Mandat pour la Palestine, malgré la volonté évidente de l’auteur d’arrimer son Livre blanc à celui de Churchill. Le socialisme radical du baron Passfield (il fut jusqu’à sa mort en 1947 un fervent admirateur de l’URSS) se ressent aussi dans sa volonté placer le commerce de la terre sous contrôle de l’État et dans l’idée — qui traverse tout le texte — qu’une communauté (les Juifs) doit renoncer à ses intérêts propres pour secourir économiquement une autre moins performante (les Arabes). Les diverses organisations sionistes firent campagne auprès du gouvernement britannique et obtinrent via une clarification du Livre blanc de Passfield envoyée par le Premier Ministre Ramsay McDonald à Chaïm Weizmann l’annulation de facto les dispositions les plus problématiques du Livre blanc de Passfield. Le libre accès à l’immigration des Juifs en Palestine sauva de nombreuses vies à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.
La Commission Peel
Le début des années 1930 vit la montée en puissance du nazisme en Allemagne et le rapprochement de intelligentsia politique et religieuse musulmane de Palestine avec le parti de Hitler pour lutter contre l’ennemi commun britannique. Dès 1933, le Grand Mufti de Jérusalem Mohammed Amin al-Husseini correspondit avec Heinrich Wolff (le consul général de l’Allemagne en Palestine) :
Le Mufti informa Wolff que les musulmans en Palestine et ailleurs étaient enthousiastes au sujet du nouveau régime en Allemagne et espéraient que le fascisme allait se répandre dans toute la région. Wolff transmit également le soutien du Mufti aux buts de la politique juive nazie, … son engagement à faire de semblables efforts contre les Juifs dans l’ensemble du monde islamique. (Gilbert Achcar, Les Arabes et la Shoah, p. 221)
En avril 1936, les Arabes enflammèrent le pays par des actions de grève générale que les Britanniques tentèrent de briser. Ils demandaient l’arrêt total de l’immigration juive et de la vente de terrains agricoles à des Juifs. Les Arabes refusèrent aussi de payer les impôts. La révolte devint vite violente. Les Arabes attaquaient les Juifs, saccageaient leurs propriétés agricoles et les quartiers juifs dans les villes mixtes. Ils s’en prenaient aussi aux infrastructures publiques telles que les pipelines et les lignes de chemin de fer. Des combattants arabes affluaient de Syrie, d’Irak et de Transjordanie. La répression britannique fut elle aussi féroce. Les Britanniques bannirent les partis arabes nationalistes (à l’exception du plus modéré d’entre eux : le Parti de la défense nationale), procédèrent à des descentes nocturnes chez les militants, usèrent de la détention préventive, confisquèrent des biens arabes et déportèrent même des éléments les plus radicaux. L’armée britannique fut appelée en renfort.
Pour trouver une solution politique au conflit, la Grande-Bretagne nomma en 1937 la Commission Peel. Dans son rapport, celle-ci proposa une partition territoriale de la Palestine en un État juif, un État arabe et une zone comprenant Jérusalem et Jaffa passant sous un nouveau régime semblable à un Mandat, mais permanent (voir la carte ci-dessous). Le plan Peel prévoyait également un transfert de population de 225.000 Arabes et 1.250 Juifs.

Il est important de noter ici que le plan Peel allait à l’encontre du Mandat pour la Palestine. Comme mandataire, la Grande-Bretagne ne pouvait prendre seule l’initiative de diviser le territoire. Il lui fallait l’accord du mandant — le peuple juif — et de la SDN. En août 1937, le 20e Congrès sioniste prit la résolution de rejeter non seulement la recommandation de partition de la commission Peel, mais aussi toutes les mesures restrictives annexes contraires au Mandat que la Grande-Bretagne avait reçu :
Le Congrès rejette l’affirmation de la Commission royale palestinienne selon laquelle le Mandat s’est révélé irréalisable et exige son accomplissement. Le Congrès ordonne au pouvoir exécutif de résister à toute violation des droits du peuple juif internationalement garantis par la Déclaration Balfour et le Mandat.
[…]
Le Congrès condamne les « propositions palliatives » présentées par la Commission royale comme une politique de mise en œuvre du Mandat, comme la réduction de l’immigration, la fixation d’un haut niveau politique en remplacement du principe de capacité d’absorption économique, la fermeture de certaines parties du pays à l’installation des Juifs, les limitations sur l’acquisition de terres, etc. Ces propositions sont une parodie du Mandat et une violation des promesses internationales, et s’avéreraient destructrices de l’avenir du Foyer national.
[…]
Le Congrès déclare que le plan de partition proposé par la Commission royale est inacceptable.
Mais, suivant la recommandation de Chaim Weizmann de ne pas fermer la porte à la Grande-Bretagne lorsqu’elle parlait pour la première fois explicitement d’un État juif, le Congrès décida d’autoriser son « pouvoir exécutif à entamer des négociations en vue d’établir les conditions précises du gouvernement de Sa Majesté pour la création proposée d’un État juif, » tout en précisant que, « dans de telles négociations, l’Exécutif ne s’engage ni lui-même ni n’engage l’Organisation Sioniste, mais en cas d’émergence d’un projet définitif pour la création d’un État Juif, un tel projet doit être porté devant un Congrès nouvellement élu pour décision. »
De leur côté, les Arabes de Palestine rejetèrent catégoriquement le plan Peel. Quant au gouvernement britannique, il vota secrètement contre le plan Peel le 8 décembre 1937, mais nomma néanmoins une commission — la Commission Woodhead — pour étudier la possibilité d’une partition de manière détaillée et technique. Celle-ci étudia le Plan Peel ainsi que deux autres plans de partition et présenta son rapport le 9 novembre 1938. Le rapport déclarait infaisable toute idée de partition pour le motif principal que l’État arabe ainsi formé serait économiquement trop faible :
Il n’est pas possible, en vertu de notre mandat, de recommander des limites qui offriront une perspective raisonnable d’établissement éventuel d’un État arabe autonome. Cette conclusion est, à notre avis, également valable dans le plan C, dans le plan B [NDLR : le plan A est le plan Peel déjà rejeté] et dans tout autre plan de partition qui n’implique pas l’inclusion dans l’État arabe d’une zone contenant un grand nombre de Juifs dont les contributions aux recettes fiscales pourraient seules assurer l’équilibre budgétaire d’un tel État.
À la suite de ce rapport, le gouvernement britannique enterra officiellement l’idée de partition.
Le Troisième Livre blanc
Après la publication du rapport Peel, les actes de sabotage et les attaques terroristes contre les Britanniques et les Juifs reprirent. Le 26 septembre 1937, le Commissaire britannique pour la Galilée fut assassiné. Les autorités britanniques ordonnèrent la dissolution du Haut Comité arabe et des divers Comités nationaux locaux, elles arrêtèrent et déportèrent plusieurs leaders arabes. Les autorités démirent aussi le Mufti de Jérusalem Haj Amin al-Husseini du Conseil suprême musulman et du Comité général du Waqf. Par crainte d’être arrêté, celui-ci se réfugia au Liban. Les Britanniques fermèrent les frontières de la Palestine. Les représailles étaient parfois de nature collective (destruction des maisons des terroristes arabes, voire de villages).
Les Juifs appuyèrent les Britanniques et organisèrent leur propre force d’autodéfense : la Haganah. Après les troubles de 1929, celle-ci s’était considérablement renforcée. En 1936, elle mobilisait 10.000 hommes (et pouvait compter sur 40.000 réservistes). À coté de la Haganah, existait aussi l’Irgun, une force d’autodéfense plus petite indépendante de l’Agence juive et politiquement proche du sionisme révisionniste. Jusqu’en 1937, la Haganah et l’Irgun pratiquaient une politique de retenue — la havlagah — qui consistait à défendre les Juifs et leurs propriétés sans chercher la revanche ni passer à l’offensive contre les Arabes. En avril 1937, l’Irgun se divisa sur la question de la retenue : la moitié des forces fusionna avec la Haganah, l’autre moitié continua à opérer de façon souterraine sous le nom Irgun et passa à l’offensive contre les Arabes en commettant une soixantaine d’attentats entre 1937 et 1940.
En septembre 1939, plus de 5.000 Arabes, 300 Juifs et 262 Britanniques avaient perdu la vie.
La Seconde Guerre mondiale approchant, la Grande-Bretagne avait impérativement besoin de calmer la situation au plus vite. En février 1939, elle convoqua les leaders Juifs et Arabes à la Conférence du Palais Saint James pour discuter de l’avenir de la Palestine et de la terminaison du Mandat. La Grande-Bretagne prévint les parties qu’en cas d’échec, elle imposerait sa propre solution. Les Arabes demandaient : (i) l’indépendance, (ii) le rejet d’un Foyer national juif en Palestine, (iii) le remplacement du Mandat par un traité et (iv) la fin de toute immigration juive. Les demandes de la délégation juive (emmenée par David Ben Gourion) étaient opposées : (i) le refus d’un statut de minorité pour la communauté juive en Palestine, (ii) la continuation du Mandat, (iii) la continuation de l’immigration juive, uniquement conditionnée par la capacité d’absorption du pays, (iv) des investissements pour accélérer le développement de la Palestine. Les demandes étant inconciliables, la conférence se termina sur un échec . . . deux jours plus tôt Hitler envahissait la Tchécoslovaquie.
Le 17 mai 1939, le Secrétaire d’État aux Colonies du gouvernement Chamberlain, Malcolm John MacDonald, publia le Troisième Livre blanc. Il était destiné à désengager la Grande-Bretagne de la Palestine dans un délai de dix ans et à s’assurer — en prévision de la guerre qui s’annonçait en Europe — le soutien des Arabes. Le Livre blanc de MacDonald prévoyait comme mesures phares :
- La limitation de l’immigration juive au cours des cinq années suivantes à environ 75.000 individus — la population juive atteindrait ainsi un tiers de la population totale — après quoi les chiffres seraient fixés par accord avec les Arabes palestiniens.
- Des restrictions sur les parties du pays où les Juifs pourraient acheter des terres.
- La nomination graduelle de Palestiniens, juifs et arabes, à des postes administratifs supérieurs dès que la paix et l’ordre seraient restaurés.
- Le transfert de tous les pouvoirs, après une période de dix ans, à un gouvernement représentatif binational.
Les organisations juives dénoncèrent immédiatement le Livre blanc de MacDonald comme contraire au Mandat pour la Palestine et appelèrent à la grève générale le 18 mai. Le 22 Mai 1939, une motion disant que le Livre blanc de MacDonald était incompatible avec le Mandat pour la Palestine fut débattue à la Chambre des communes britannique. La motion fut rejetée à 268 voix contre 169. Winston Churchill (Secrétaire aux colonies quand le Mandat entra en vigueur et auteur du Premier Livre blanc) et David Lloyd George (Premier ministre britannique ayant négocié les Accords de San Remo et le Mandat pour la Palestine) votèrent contre le Livre blanc de MacDonald ; David Lloyd George qualifia même le Livre blanc de 1939 d’ « acte de perfidie ».

En juin 1939, le Mufti de Jérusalem Amin al-Husseini rejeta lui-aussi le Livre blanc de MacDonald tandis que d’autres leaders arabes palestiniens semblent en avoir accepté officieusement les termes. Ce même mois, malgré son rejet par le mandant, le Livre blanc de MacDonald fut soumis à la Commission permanente des Mandats de la SDN pour approbation.
La Grande-Bretagne devant la Commission permanente des Mandats
La Commission permanente des Mandats, réunie dans sa 36e session à Genève, discuta du problème posé par le Livre blanc de MacDonald entre le 15 et le 29 juin 1939 lors des séances 12-16, 20, 22-23, 27-28 et 30-33. Le Secrétaire d’État aux Colonies, Malcolm MacDonald, s’y présenta en personne pour exposer et défendre la nouvelle politique britannique en Palestine. Il espérait obtenir l’aval de la SDN à son exécution.
La commission était présidée par M. Pierre Orts (BE). Ses six autres membres étaient : M. William Rappard (Vice-Président, CH), Baron Frederik van Asbeck (NL), Mlle Valentine Dannevig (NO), M. Émile Giraud (FR), Lord Maurice Hankey (GB), Comte de Panha Garcia (PO).
Malcolm MacDonald exposa (i) la nouvelle politique migratoire, (ii) les nouvelles règles concernant la vente des terres, (iii) la situation politique en Palestine. Il soutint que la nouvelle politique de la Grande-Bretagne était en conformité avec le Mandat reçu de la SDN et ne se distinguait des politiques précédentes que par un « changement d’accent » à la faveur des Arabes, alors que dans les années précédentes l’accent avait été à la faveur des Juifs.
Il précisa aussi que la nouvelle volonté de la Grande-Bretagne était de fonder en Palestine un État binational dans lequel les Juifs représenteraient un tiers de la population et les Arabes deux tiers. Il favorisait (sans l’imposer) une structure fédérale au nouvel État dans laquelle une constitution (dont les contours n’étaient pas précisés et qui serait rédigée dans les cinq dernières années du Mandat) permettrait aux Juifs de ne pas être assujettis à la supériorité démographique des Arabes.
Les membres de la Commission auditionnèrent le Secrétaire d’État britannique de façon approfondie sur toutes les questions sensibles. Le compte rendu intégral des travaux de la Commission permanente des Mandats peut être consulté ici (crédit : United Nations Archives at Geneva).
À l’issue de l’audition, la Commission débattit (i) de la conformité du Livre blanc de MacDonald avec la lettre et l’esprit du Mandat britannique et (ii) s’il existât une manière de réinterpréter le Mandat qui fût compatible avec la nouvelle politique.
Dans son allocution de clôture des débats, le Président de la Commission permanente des Mandats eut ces mots:
N’est-on pas fondé alors à entrevoir au bout de cette politique (NDLR: le Livre blanc de 1939), pour le Foyer national juif, de toutes autres perspectives que celle de l’optimisme que la Commission a entendu exprimer ? Il faut se rappeler le passé : par le détachement de la Transjordanie, exclu dès le début d’une partie des pays qui lui étaient promis ; par la reconnaissance du principe de la double obligation (NDLR: MacDonald réinterprétait le Mandat à la faveur égale aux Juifs et Arabes), limité juridiquement dans son développement ; par la suspension provisoire de l’application du critère de la capacité d’absorption économique (NDLR: seul critère limitant l’immigration juive depuis le Livre blanc de Churchill) et, ensuite, par la substitution à ce critère d’un critère politique, contrarié dans sa source, le Foyer national juif dans un État indépendant à majorité arabe à jamais stabilisée, verrait ses destinées aux mains de ceux qui ne lui pardonnent pas d’exister.
Dans son rapport au Conseil de la SDN (transmis le 17 août 1939), la Commission jugea à l’unanimité que « la politique exposée dans le Livre blanc n’était pas conforme à l’interprétation que, d’accord avec la Puissance mandataire et le Conseil, la Commission a toujours donnée du Mandat pour la Palestine. » Cette interprétation orthodoxe est celle exposée dans cet article à la section « Le mandat pour la Palestine ».
Quant à la question – plus difficile – de savoir si la nouvelle politique britannique et la perspective d’un État de Palestine binational où les Juifs seraient minoritaires pouvait être jugées compatibles avec une nouvelle interprétation du Mandat, la Commission statua à une majorité de quatre avis (Orts, Rappard, Dannevig, van Asbeck) contre trois (Hankey, Penha Garcia, Giraud) que ce n’était pas non plus le cas.
Situation juridique en 1939
À la veille de la Seconde guerre mondiale, le Mandat pour la Palestine, dans son interprétation orthodoxe – confirmée par la Commission des Mandats de juin 1939 – demeurait le seul instrument de droit international régissant l’avenir de la Palestine, dans son entièreté de la mer au Jourdain. Le Mandat avait été créé à la faveur du mandant : le peuple juif. L’égalité des droits individuels, civils et religieux, de tous les autres peuples et communautés du pays (Arabes chrétiens et musulmans, Druzes, etc.) devait être préservée.
Le développement du Foyer national juif devait se baser sur une immigration juive favorisée et l’assistance de la puissance mandataire pour le développement de l’industrie et de l’agriculture afin de permettre au peuple juif de se « tenir debout» seul dans le concert des nations (au sens de l’Art. 22 du Pacte de la Société des Nations) lorsque l’indépendance serait déclarée et le Mandat abrogé.
Les Livres blancs britanniques n’était pas des instruments de droit international, mais des déclarations d’intentions politiques produites par la Puissance mandataire détaillant la façon dont elle envisageait d’exécuter son Mandat. Ils étaient soumis à l’aval de la SDN. Le Livre blanc de MacDonald fut ainsi invalidé et déclaré non conforme au Mandat.
L’examen du rapport de la Commission permanente des mandats de juin 1939 était prévu au Conseil de la SDN de septembre 1939, mais pour les raisons liées à la situation internationale, le Conseil fut reporté. Le Conseil suivant (9 décembre 1939) fut entièrement dédié à l’invasion de la Finlande par l’URSS qui venait de se produire le 30 novembre 1939. Le Conseil n’a plus siégé ensuite.
Entretemps, en violation du droit international, la Grande-Bretagne mis en place les restrictions de vente de terres aux Juifs dès février 1940.
Suite dans la Partie 2 …